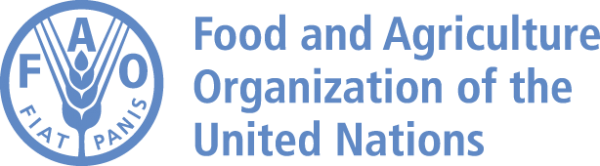Résultats de la recherche
Displaying 191 - 200 of 1137 results.
Medición de la innovación agropecuaria desde los territorios: una propuesta conceptual y metodológica
Los aportes de la agricultura para el país son indiscutibles: cerca del 20% al Producto Interno Bruto, 40% del empleo nacional, alimentos; aunque la mayoría de cultivos se producen en sistemas convencionales algunos como el café y el cacao son generadores de servicios ecosistemicos como la captura de carbono y la infiltración de agua. Así mismo, la agricultura es generadora de cohesión social comunitaria y un extraordinario reservorio de cultura popular. Tres elementos de contexto ponen en riesgo este carácter multifuncional de la agricultura.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)systèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationsystèmes de connaissances et d'informationTIC (Technologies de l'information et de la communication)Knowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage organisationnelprocessus multipartitesréseaupolitiquesengagement du secteur privédéveloppement ruralsecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2015Inclusión óptima de los jóvenes en la agricultura y los territorios rurales
Este documento está pensado para dar una respuesta integrada a las necesidades específicas de los jóvenes rurales, trabajando desde temas de empoderamiento personal y grupal como autoestima, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, etc.; hacia otros más técnicos como asociatividad, generación de empresas, formulación de proyectos, gestión territorial y políticas públicas, entre otros. Procurando con ello una preparación más holística para enfrentar los retos de la ruralidad y las capacidades suficientes para tener un mejor acceso a las oportunidades de su entorno.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCcommunicationfacilitationsystèmes d'exploitation agricoleÉgalité entre les sexessystèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationsystèmes de connaissances et d'informationTIC (Technologies de l'information et de la communication)Knowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageprocessus multipartitesréseaupolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicagriculture durablechaînes de valeursecteur agroalimentaire...
Année de publication:
2017La innovación para el logro de una agricultura competitiva, sustentable e inclusiva
El IICA ha elaborado este libro, La innovación para el logro de una agricultura competitiva, sustentable e inclusiva, para ofrecer a los países miembros, a los gobiernos, a los productores y a los actores relacionados con la agricultura continental una visión panorámica de este tema central para el sector agrícola.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCsécurité alimentaire et nutritionnellesystèmes d'innovationinnovationsystèmes de connaissances et d'informationTIC (Technologies de l'information et de la communication)Knowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage institutionnelapprentissage organisationnelprocessus multipartitesréseauapproches participativesengagement du secteur privéengagement du secteur publicdéveloppement ruralcoopération Sud-Sudagriculture durablesecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2017Innovation to achieve competitive, sustainable and inclusive agriculture
ICA has developed this book, Innovation to achieve competitive, sustainable and inclusive agriculture with the purpose of offering member countries, governments, farmers and stakeholders in the continent an overview of this central issue for the agricultural sector. The document explains the importance of agricultural innovation and the way in which IICA has addressed and developed, based on the guidelines defined by the Heads of State and the Ministers of Agriculture of the Americas, the actions included in the strategic plan and the medium-term plans.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCsécurité alimentaire et nutritionnellesystèmes d'innovationinnovationsystèmes de connaissances et d'informationTIC (Technologies de l'information et de la communication)Knowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage institutionnelapprentissage organisationnelprocessus multipartitesréseauapproches participativesengagement du secteur privéengagement du secteur publicdéveloppement ruralcoopération Sud-Sudagriculture durablesecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2017Les conventions locales pour la gestion des ressources naturelles au Sénégal : Entre autonomisation et problème d’appropriation
Les conventions locales peuvent être définies comme des accords légitimes négociés entre plusieurs parties prenantes (stakeholders) dans une perspective de régulation des ressources naturelles – en termes de contrôle, d’accès, d’appropriation, d’usage et d’exploitation – et de l’environnement. Au Sahel, bien qu’elles soient en vogue et jouissent davantage d’attention chez les décideurs, elles constituent des instruments encore peu exploités dans le contexte actuel de la décentralisation (Diallo, 2003).
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCcommunicationsystèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeprocessus multipartitesnégociationréseauapproches participativespolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicrechercherecherche participativedéveloppement ruralagriculture durable...
Année de publication:
2011Perception et gestion de l'érosion et des ressources en eau par les agriculteurs et les éleveurs du bassin versant de l'Ibicuí (RS, Brésil)
L’ouest du Rio Grande do Sul est dominé par la culture du soja, du riz et par l’élevage bovin. Dans la partie sableuse, le milieu est affecté par des phénomènes d’érosion produisant des modelés éoliens spectaculaires (arenização) rappelant dans l’imaginaire ceux des déserts. La production agricole est importante ce qui engendre des prélèvements d’eau pour l’irrigation du riz, mais aussi l’utilisation de pesticides pour l’ensemble des cultures. La gestion durable des ressources en eau et en sol de cette région nécessite la mise en place d’action de conservation.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCchangement climatiquecommunicationsystèmes d'exploitation agricolesystèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationsystèmes de connaissances et d'informationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage institutionnelprocessus multipartitesréseaupolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicrechercherecherche participativedéveloppement ruralagriculture durablesecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2008Plan de renforcement des capacites dans le domaine agricole pour la reduction de la pauvrete au Cameroun
L’objectif de ce travail est de proposer un plan de formation des différents catégories d'acteurs (à identifier) dans le but d'apporter une contribution significative au renforcement de capacité dans chaque pays et dans la sous-région. Des actions précises visant à permettre aux acteurs de lever les éventuels blocages institutionnels devront accompagner ce processus de renforcement des capacités, notamment en ce qui concerne la négociation, le lobbying, la mise en réseau etc.
Les résultats attendus de ce travail sont :
Sujet(s):
courtagerenforcement des capacités (RC)Concepts au sujet de RCOutils au sujet de RCcommunicationsystèmes d'exploitation agricolesécurité alimentaire et nutritionnelleinnovationpolitiques d'innovationsystèmes de connaissances et d'informationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissagesuivi et évaluation (S&E)outils de S & Eprocessus multipartitesévaluation des besoinsnégociationréseauapproches participativespolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicrecherchedéveloppement rural...
Année de publication:
2005Plan d’action pour la gestion des risques agricoles au Niger (PAGRA) 2014-2023
L' étude de la Banque Mondiale a identifié des mesures d’atténuation pouvant apporter des solutions à court et à long termes aux problèmes du secteur agricole du Niger. Il s’agit, notamment de :
l’utilisation de variétés à haut rendement résistantes à la sécheresse,
l’application de techniques de CES/DRS et de gestion des ressources naturelles,
l’extension des surfaces sous irrigation,
la lutte préventive contre les criquets pèlerins,
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Concepts au sujet de RCOutils au sujet de RCchangement climatiquecommunicationsystèmes d'exploitation agricolesécurité alimentaire et nutritionnelleÉgalité entre les sexessystèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationsystèmes de connaissances et d'informationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localesuivi et évaluation (S&E)outils de S & Eprocessus multipartitesévaluation des besoinsréseauapproches participativespolitiquesPolitiques de vulgarisationengagement du secteur privéengagement du secteur publicdéveloppement ruralagriculture durablechaînes de valeursecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2013L’organisation des marchés de producteurs de fruits et légumes biologiques à Nairobi, Kenya
La consommation de produits certifiés n’est plus l’apanage des pays développés. Au Kenya, les premiers marchés biologiques sont apparus à Nairobi en 2006. Ils sont approvisionnés par des maraîchers, confrontés à une diversité de défis : construire une certification biologique crédible, garantir la fraîcheur des produits et composer avec l’hétérogénéité des attentes des consommateurs. À partir de données d’enquête et du cadre analytique des coûts de transaction, nous analysons l’organisation des marchés de 2006 à 2013.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCcommunicationsystèmes d'innovationinnovationsystèmes de connaissances et d'informationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage institutionnelapprentissage organisationnelprocessus multipartitesréseauapproches participativesengagement du secteur privérecherchedéveloppement ruralagriculture durablechaînes de valeursecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2017L’agroécologie: s’adapter au changement climatique dans les zones semi-arides aux fins d’un développement agricole durable
La capacité de la région Proche-Orient et Afrique du Nord à réaliser des avancées majeures dans la concrétisation du deuxième Objectif de développement durable (ODD 2) dépendra, dans une large mesure, de la gestion durable des ressources en eau pour l’agriculture et de l’adaptation au changement climatique. La transformation agricole dans cette partie du monde a suivi une trajectoire particulière ayant conduit à un déséquilibre entre le développement agricole rural et urbain, qui se manifeste de manière très visible dans les systèmes de production alimentaire.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)Outils au sujet de RCchangement climatiquecommunicationsystèmes d'exploitation agricolesécurité alimentaire et nutritionnelleÉgalité entre les sexessystèmes d'innovationinnovationKnowledge management/Gestion des connaissancesConnaissance localeapprentissageapprentissage institutionnelapprentissage organisationnelprocessus multipartitesréseauapproches participativesengagement du secteur privéengagement du secteur publicdéveloppement ruralagriculture durablechaînes de valeursecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2018Pages
Sorting block
Filtrer par idiome
- engagement du secteur privé (733) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (243) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (161) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par sujet(s)
- (-) Remove networks filter networksnetworks
- (-) Remove private sector engagement filter private sector engagementprivate sector engagement
- engagement du secteur privé (140) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (72) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (102) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (809) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (149) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (201) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (64) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (167) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (223) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (112) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (169) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (267) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (110) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (71) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (878) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (392) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (356) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (156) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (506) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (147) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (135) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (279) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (457) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (500) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (419) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (355) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (35) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (311) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (607) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par auteur(s)
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (30) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (40) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (16) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (9) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (18) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (35) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (33) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (9) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par pays
- engagement du secteur privé (72) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (59) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (59) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (55) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (53) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (49) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (46) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (44) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (41) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (40) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (39) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (38) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (37) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (32) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (31) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (30) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (27) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (26) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (26) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (24) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (23) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (22) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (22) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (22) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (21) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (20) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (20) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (19) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (19) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (19) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (18) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (17) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (17) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (17) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (16) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (16) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (15) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (15) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par éditeur(s)
- engagement du secteur privé (90) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (77) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (73) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (66) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (36) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (33) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (32) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (29) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (21) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (17) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (15) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (11) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (11) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (10) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (9) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (8) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par region
- engagement du secteur privé (281) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (322) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (160) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (130) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (23) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (280) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par type
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (96) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (18) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (67) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (46) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (52) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (47) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (16) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (17) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (16) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (22) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (5) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (34) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (323) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (1) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (22) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (13) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (211) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (15) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (12) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (58) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
Filtrer par αnnée de publication
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (7) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (6) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (11) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (29) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (45) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (32) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (67) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (59) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (72) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (63) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (60) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (85) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (141) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (123) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (129) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (94) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (43) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (26) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (14) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (4) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé
- engagement du secteur privé (2) Apply engagement du secteur privé filter engagement du secteur privé